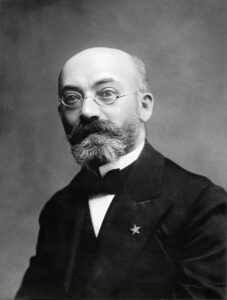[#Nous avons vu] Les Dents de la mer. La peur règne quand les yeux se ferment
Voici 50 ans, Steven Spielberg nageait à contre-courant en réalisant ce que l’on considère aujourd’hui comme le premier « blockbuster». Avec ce long-métrage de deux heures qui crée dans les salles un niveau de tension inédit, il ouvrait à coup de crocs une nouvelle voie pour le cinéma.
Les Dents de la mer est un film qui n’a pas pris une ride. Encore aujourd’hui, l’évocation de requin, de plage et de morts, avec ces quelques notes de musique bien connues suffit à réveiller l’imaginaire commun. Si l’on demandait à tout un chacun de définir le cinéma d’horreur, ce nom remonterait certainement à la surface. L’intrigue est simple et efficace : un gros requin, des nageurs, un maire buté, des hommes courageux et beaucoup, beaucoup de sang. Le reste est à découvrir.
Suggérer pour mieux frissonner
La beauté de ce film, c’est que même s’il n’y avait pas de requin à l’écran, il resterait quand même un des films les plus terrifiants du genre horrifique. Spielberg l’avait bien compris : ce qui fait peur c’est ce que l’on ne voit pas. Aucun requin n’est visible avant une bonne moitié du film, pourtant on sentirait presque sa morsure sur nos chevilles. C’est d’ailleurs l’enjeu de l’intrigue, ce qui rend cette chasse si compliquée. Comment affronter un ennemi que l’on ne connaît pas ? Une menace que l’on ne voit pas ? Difficile de ne pas sous-estimer, ou surestimer, un adversaire invisible.
La tension est rendue évidente autrement que par la chose elle-même. La musique notamment nous donne envie de nous enfuir d’un crawl énergique. Le rythme reconnaissable, le tempo qui s’accélère en même temps que les battements de cœur et l’on sait que l’on est poursuivi. Les premières images ne sont pas encore à l’écran que déjà le stress monte comme la marée. De même, les plans en contre-plongée dans l’eau sont clairs. On est à la place du requin, l’attaque va avoir lieu.
Et quand enfin apparaît la bête, force est de constater qu’elle a bien vieilli. Le fait qu’elle soit si peu à l’écran permet de conserver une partie du réalisme du film, dont les effets spéciaux ont pourtant un demi-siècle. La créature est également convaincante parce qu’elle est source de tension. On s’inquiète moins de savoir si ce sont les mouvements naturels d’un requin quand on voit l’animal en question couper quelqu’un en deux. Les litres de sang qui s’écoulent de tous les côtés sont extrêmement efficaces pour détourner l’attention. Si le «great white» n’est présent en image que quatre minutes, il nage dans les esprits bien des heures après la fin de la séance.
Attendre pour mieux surprendre
Spielberg sait aussi qu’il n’est pas nécessaire de faire de son film une épreuve de vitesse. La peur a besoin de temps, la surprise surgit quand le calme semblait certain. Un premier ressort de cette tension montante est l’alternance de plans. Dans la première séquence par exemple, on alterne entre la jeune femme (la proie) qui nage dans les eaux sombres et le jeune homme qui se déshabille sur joli fond de coucher de soleil. On sait qu’il perd du temps, que la victime, elle, perd son sang, mais le tempo n’accélère pas, l’horreur dure. Le rythme est clé, la mélodie et les sons de l’intrigue, comme la parade de la fête nationale qui s’entraîne, battent la mesure. On ne nage pas plus vite que la musique.
La deuxième partie du film se laisse le temps du suspense. Quelques jours de bateau semblent durer une éternité. Et le doute s’installe : s’en sortiront-ils ? La chasse est en cours, mais il devient difficile de savoir qui tient le harpon. Encore une fois, on joue à «1, 2, 3, soleil !» avec le requin et avec l’horloge. Les plans se succèdent rapidement, d’abord le bateau, son moteur ou le matériel, puis la mâchoire du requin. Bateau. Requin. Bateau. Requin, qui est cette fois prêt à croquer. Spielberg se joue des «jump scares», des sursauts, attend une seconde de trop pour nous faire hurler plus fort. Enfin, quand tout se termine, pas de remous, cette fois c’est pour de bon, plus rien à ajouter.
On notera quand même que les hommes tuent souvent plus que les animaux, et ils n’ont pas l’excuse de l’instinct primaire, juste celle de l’égoïsme. Ce n’est pas le requin qui avait les dents les plus longues.
Les Dents de la mer
De Steven Spielberg, 1975, 124min
États-Unis ; VOSTF – Langue : anglais
Avec : Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss
Diffusion : Jeudi 16 octobre à 14 h au Manège
Ange Gloaguen
Envoyé•e spécial•e au Festival international du Film de La Roche–sur-Yon