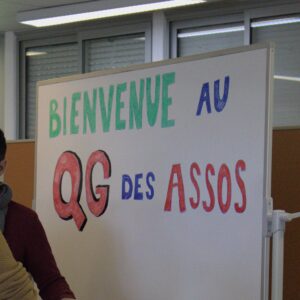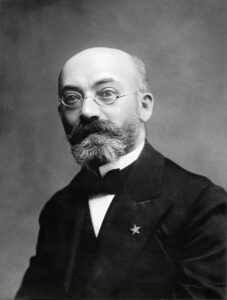La surveillance numérique, débat participatif avec Yann Bruna
Le 17 mars s’est tenu, au sein de l’IUT de La Roche-sur-Yon, un débat participatif autour du sujet de la surveillance numérique dans le cadre des JDLN 2025 (Journée Des Libertés Numériques).
Ce débat était encadré par Yann Bruna, maître de conférences en sociologie à l’Université Paris-Nanterre, chercheur au laboratoire Sophiapol et chercheur associé au Centre d’études sur les technologies de surveillance, et par Zeineb Touati, maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à Nantes Université et chercheure au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N).
La présence du numérique dans nos sociétés est de plus en plus importante, de ce fait il est normal de se questionner sur la façon dont sont utilisées nos données. Une de ses utilisations premières est la surveillance numérique qui est la surveillance exercée par un individu, un collectif/groupe ou un État sur les activités numériques d’un ou de plusieurs individus.
Que se soit dans le monde professionnel ou dans la sphère privée, la surveillance par géolocalisation est de plus en plus utilisée depuis plusieurs années. Il est possible de justifier ces actes par un besoin de sécurité ou à de la simple curiosité mais cela peut également paraître comme étant une pratique intrusive, empêchant les individus de faire quoi que ce soit sans que quiconque ne soit au courant.
Au cours de ce débat participatif, deux thèmes portant sur cette surveillance numérique ont été abordés : la surveillance des enfants par leurs parents et la surveillance par les pairs.
La surveillance numérique des enfants par leurs parents est de plus en plus répandue, en particulier en ce qui concerne leur géolocalisation ou pour bloquer les contenus inadaptés aux enfants. D’après l’étude menée par Yann Bruna, 41% des parents affirment géolocaliser leurs enfants. Cela s’explique par une insécurité des parents vis-à-vis de ce que font leurs enfants en dehors du domicile familiale. Cette surveillance a permis de résoudre des affaires de disparition, notamment celle de Louise disparue le 7 février 2025.
Mais les parents ne sont pas les seuls à utiliser la surveillance numérique au quotidien. Avoir un regard constant sur les activités numériques d’autrui est devenu une norme dans notre société technologique où grand nombre d’individus partagent quotidiennement des contenus personnels. La plupart des médias sociaux que nous utilisons permettent notamment de partager nos données, dont notre localisation, via la carte Snapchat par exemple. Savoir où se situent autrui et ses activités est devenu un besoin. Cela est tellement ancré dans notre société que ne pas partager de contenu peut être perçu comme anormal, en particulier chez les jeunes qui utilisent cette surveillance comme une donnée réputationnelle.
Le public a été réceptif aux propos de Yann Bruna, lui posant de nombreuses questions sur la surveillance numérique, ses atouts et ses possibles dérives lors de l’échange. Il nous a, par la suite, accordé une interview dans la continuité de sa conférence. Vous trouverez la retranscription de l’interview ci-dessous.

En une phrase, quelle définition donneriez-vous de la géolocalisation ?
C’est une technologie qui permet de localiser des entités géographiques dans l’espace. Par entité géographique, j’entends aussi bien des personnes que des objets tels que des points d’intérêt. Ainsi, elle facilite les déplacements, la navigation par satellite et divers autres usages, y compris la localisation individuelle.
Quelles sont les applications de géolocalisation qui sont les plus utilisées ?
Sans doute celles liées à la navigation par satellite, comme Google Maps, qui agissent comme des agrégateurs d’applications géolocalisées. Elles combinent la géolocalisation par satellite avec la recherche de points d’intérêt, les avis d’utilisateurs, et bien plus. Google Maps compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde.
Il y a aussi des concurrents comme Waze, bien que celui-ci soit un demi-concurrent car il appartient à Google. Mais j’hésiterais quand même avec d’autres applications qui utilisent beaucoup de géolocalisation. C’est par exemple les applis de rencontres qui sont massivement utilisées aussi, qui référencent des individus en fonction de leur position géographique. Et un peu plus loin, des applis de contrôle parental, et donc d’autres formes de géolocalisation.
Est-ce que lorsque nous désactivons la géolocalisation sur nos applications ou nos appareils, nous continuons d’être localisés ?
Oui, par exemple, via la carte SIM. Cependant, une fois que toutes les fonctions sont désactivées, il est difficile pour quiconque de nous géolocaliser. C’est une bonne nouvelle, mais il reste toujours possible de suivre un smartphone. Donc, pour ceux qui veulent éviter d’être localisés, la première étape serait de se séparer de leur smartphone, voire même de leur carte SIM, et de tout autre appareil connecté, y compris les montres intelligentes.
Hormis la carte SIM, y a-t-il des applications qui peuvent nous géolocaliser, même lorsque le téléphone est éteint ou les applications désactivées ?
Alors, non pas directement, mais la dernière position enregistrée reste valide, similaire à une géolocalisation par carte bancaire ou un retrait, où une empreinte temporelle peut indiquer où nous étions à un moment donné, mais pas en temps réel.
Quels sont les risques d’une surveillance excessive ou abusive par cette technologie ?
En ce qui concerne la surveillance interpersonnelle, le risque d’utilisation abusive est intrinsèque à cette technologie. Ce qui est jugé abusif est souvent subjectif : certains peuvent trouver la géolocalisation rassurante, tandis que d’autres la considèrent immédiatement intrusive, même si elle n’est pas en temps réel. Cela dépend largement des perceptions individuelles.
Les jeux en réalité augmentée, comme Pokémon Go, utilisent de plus en plus la géolocalisation. Comment voyez-vous l’évolution future de cette technologie ?
L’évolution pourrait inclure une intégration accrue avec la reconnaissance faciale et d’autres technologies liées aux vastes bases de données ou au Big Data, alimentant les intelligences artificielles générales. Des exemples comme le crédit social chinois montrent comment de telles technologies pourraient être utilisées pour attribuer des scores aux citoyens en fonction de diverses données comportementales et géographiques.
Quelles lois encadrent l’utilisation de la géolocalisation intrapersonnelle en France et dans d’autres pays ?
C’est une très bonne question, parce qu’en France, on n’a pas le droit de géolocaliser quelqu’un sans son consentement. Si l’on veut géolocaliser une personne majeure, il faut absolument l’en informer et obtenir son accord.
Là où ça devient plus intéressant, c’est dans le cas des parents qui souhaitent géolocaliser un mineur. En tant que responsable légal, rien ne vous interdit de le faire. Bien sûr, ça reste intrusif, mais légalement, c’est autorisé.
Je parle là du contexte français, mais c’est valable aussi au niveau européen. Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) est commun à tous les pays de l’Union européenne, même s’il existe quelques spécificités nationales. Par exemple, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) en France a été fondée en 1978 avec la loi Informatique et Libertés. Ce sont donc des questions qu’on se pose depuis longtemps en France.
Quelles sont les similitudes et les différences dans les pratiques de surveillance à travers le monde ?
Les pratiques de surveillance varient, mais des exemples comme Pegasus montrent des préoccupations mondiales concernant l’utilisation abusive des données de géolocalisation. Les différences culturelles et juridiques peuvent influencer la manière dont ces technologies sont utilisées et régulées, par exemple avec des entreprises technologiques opérant dans des environnements politiques divers.
Pensez-vous que la surveillance des personnes âgées par leurs enfants soit nécessaire ?
Je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas de faire de prescription. Mais c’est une vraie question. Aux États-Unis, l’Apple Watch est remboursée par certaines mutuelles parce qu’elle détecte les chutes. Si une personne âgée chute, la montre peut envoyer une alerte aux services d’urgence. Au-delà de ça, ces objets connectés sont capables de détecter des arythmies cardiaques, ou les prémices d’un AVC. Ils peuvent prévenir la famille ou les secours en cas de problème. La vraie question derrière tout ça, c’est : qu’est-ce que je peux faire grâce à ces technologies que je ne pourrais pas faire sans elles ? Est-ce que j’aurais pu éviter les conséquences d’une chute si j’avais équipé ma grand-mère d’une montre connectée ? Peut-être. Mais il faut aussi respecter le souhait des personnes concernées : certaines personnes âgées n’ont pas envie d’être surveillées ou d’être assistées en permanence. Ce sont des questions importantes.
Pourquoi la fonction « message vu » dans les applications de messagerie instantanée crée-t-elle une pression pour des réponses instantanées ?
Parce que quand vous me posez une question, vous attendez que je vous réponde tout de suite. C’est le principe même de la messagerie instantanée : contrairement à un mail qui est asynchrone, on attend une réponse rapide. Derrière ça, il y a une question plus large sur notre rapport au temps dans une société hyper-connectée.
Quand un message a été lu, on attend logiquement une réponse rapide. Cela dit, on peut espérer que la personne prenne un peu de temps pour réfléchir à sa réponse, surtout dans un contexte personnel ou intime. Mais les outils numériques renforcent cette pression : les trois petits points qui s’affichent indiquent que la personne est en train d’écrire, les notifications, les métadonnées… Tout cela participe à un environnement où la passivité n’existe plus vraiment dans la communication. Et parfois, ces métadonnées en disent bien plus sur la relation entre deux personnes que le contenu même des messages échangés.
La géolocalisation est souvent utilisée par les parents pour surveiller leurs enfants. Comment équilibrer sécurité et respect de la vie privée des jeunes ?
Sans doute par la négociation. Mais cette négociation dépend beaucoup du contexte social et des capacités des jeunes à argumenter ou à négocier avec leurs parents. Tout le monde n’est pas égal face à ça. Tous les parents ne sont pas aussi ouverts à la discussion. Dans les milieux populaires, par exemple, les études sociologiques montrent que la variable d’ajustement dans l’éducation numérique, c’est souvent le temps d’écran : « Tu as droit à deux heures », « Tu as dépassé ton quota », etc., plutôt que la réflexion sur les usages ou le type d’activité réalisée en ligne.
Enfin, partager sa localisation avec des amis est devenu courant. Pensez-vous que cela puisse affecter les relations amicales ?
Oui, bien sûr. Toute forme de surveillance peut avoir des conséquences sociales. Ça peut même, à terme, devenir une forme de charge mentale. Par exemple, si vous faites un mauvais usage de ces technologies, ou si vous oubliez de désactiver votre géolocalisation à un moment où cela pourrait être compromettant pour vous, ça peut entraîner des conséquences dans vos relations personnelles. Quand vous géolocalisez quelqu’un, vous vous placez souvent, consciemment ou non, dans un rapport de pouvoir. C’est une posture de contrôle, de surveillance, de celui qui observe l’autre.
Mais en même temps, il faut aussi se rappeler que l’autre peut vous géolocaliser également. Et à long terme, si vos amis ou vos proches perçoivent que vous êtes trop intrusif, cela peut se retourner contre vous. Vous pouvez être perçu comme quelqu’un qui ne respecte pas suffisamment la vie privée des autres. Donc oui, il peut y avoir un vrai impact sur les relations amicales : cela peut renforcer le lien social et la proximité, mais aussi générer des tensions, un sentiment d’intrusion, ou une forme de surveillance pesante. Tout dépend de la manière dont c’est utilisé et du degré de confiance dans la relation.